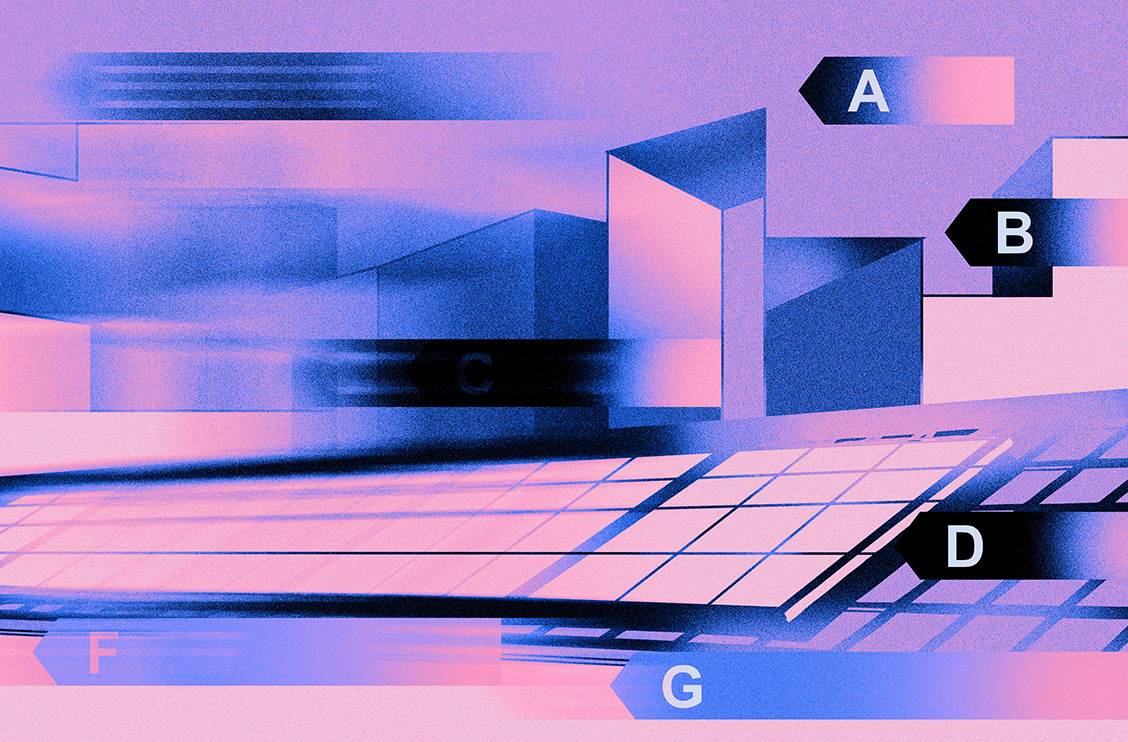
Le parc immobilier a un rôle crucial à jouer pour atteindre la neutralité carbone
Aujourd’hui responsable d’environ 16 % des émissions de gaz à effet de serre en France (source : Haut Conseil pour le Climat), le parc immobilier doit être profondément transformé pour contribuer à la neutralité carbone. Conscient de ce défi, le gouvernement a multiplié les mesures incitatives et réglementaires, à commencer par l’obligation de publier un Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) pour toute nouvelle vente ou mise en location de logements.
Les enjeux économiques d’une rénovation énergétique
Les rénovations énergétiques constituent cependant un investissement lourd, incluant généralement des travaux conséquents d'isolation et le remplacement du système de chauffage, entre autres. Leurs coûts peuvent représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros, même après déduction des aides publiques. Dès lors, la question de leur rentabilité économique devient centrale pour les propriétaires (occupants ou bailleurs). Afin de mieux appréhender les enjeux économiques liés à la rénovation énergétique, nous avons cherché à quantifier la valeur verte – c’est-à-dire la plus-value espérée après travaux – et à comprendre comment elle varie selon la pression du marché local, mesurée par les zones Pinel.
Effets sur les prix et les loyers
Notre démarche s’articule en deux temps : dans une première partie, nous analysons l’impact des classes DPE sur les prix d’achat des maisons et appartements ; dans une seconde partie, nous examinons leur effet sur les loyers des logements.
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un indicateur de la performance énergétique d’un logement. Depuis 2021, les classes DPE tiennent compte de deux critères : la consommation d’énergie primaire (chauffage, eau chaude, refroidissement) d'une part, et les émissions de gaz à effet de serre d'autre part. Le DPE classe les biens sur une échelle allant de A à G, où A correspond aux logements les plus économes en énergie (moins de 70 kWh/m2/an et moins de 6 kg d’équivalents CO2/m2 émis par an) et G aux plus énergivores (plus de 420 kWh/m²/an, et plus de 100 kg de CO2eq/m²/an). La classe finale du DPE est déterminée par la note la plus faible entre la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre.
Pour évaluer l’impact du DPE sur les prix, nous avons exploité une base de près de 40 000 transactions (20 371 appartements et 20 194 maisons) réalisées en France entre 2023 et 2024. Il s’agit d’échantillons représentatifs provenant de la base notariale officielle (BIEN pour l’Île-de-France et ADNOV pour les régions). Pour chaque bien, nous disposons de nombreuses informations telles que la surface, la localisation, le nombre de pièces, l’état général, ainsi que sa classe DPE.
La répartition des ventes dans nos échantillons met en évidence que les catégories C, D et E représentent plus de 75 % du marché, tandis que les logements très performants (classes A et B) ne constituent qu’environ 6 % des transactions, pour les maisons comme pour les appartements. Les « passoires thermiques » (classes F et G) pèsent quant à elles 18 % des ventes de maisons et 12 % de celles d’appartements (figure 1).
Une autre dimension centrale de notre étude est la tension du marché. La valeur verte après rénovation pourrait en effet être différente selon que le logement se trouve dans une zone de marché particulièrement tendue ou pas. Le zonage Pinel, introduit en 2014, est une mesure utile à cet égard : il divise la France en 5 catégories : A bis (Paris et sa petite couronne, zone la plus tendue), A, B1, B2 et C (zone la moins tendue, voir encadré pour plus d’informations).
La zone C représente 83 % des communes de France métropolitaine, et concentre 45 % des transactions de maisons individuelles de notre échantillon. En revanche, seules 7 % des ventes d’appartements y sont réalisées. À l’opposé, près de la moitié des transactions d’appartements ont lieu dans les zones les plus tendues, A et A bis (figures 2 et 3)
Les figures 4 et 5 présentent la distribution des prix de transactions des maisons et des appartements par zones Pinel. Sans surprise, les prix médians au mètre carré sont d’autant plus élevés que l’on se situe dans une zone tendue (près de 8 000 euros par m2 en zone A bis pour les appartements, contre 1 600 en zone C)
Pour les maisons individuelles, on observe une diminution progressive des prix médians au mètre carré à mesure que la classe énergétique se dégrade - de près de 3 000 euros au m2 pour les maisons classées A à 1 400 pour celles classées G (figure 6). Pour les appartements, la situation est plus nuancée. Si l’on observe bien une baisse des prix médians entre les classes A et D, cette relation devient moins évidente au-delà. Les prix médians ont tendance à remonter pour les classes E, F et G, et surtout, la dispersion des prix devient extrêmement importante (figure 7). Cette hétérogénéité s’explique notamment par la diversité des biens vendus : dans ces classes énergétiques basses, on trouve à la fois des logements vétustes, vendus à bas prix, et des biens anciens, certes énergivores, mais situés dans des quartiers extrêmement recherchés, à Paris par exemple, dont les prix peuvent alors dépasser les 10 000 euros par m2.
Cette diversité souligne la nécessité de ne pas s’arrêter aux simples moyennes ou médianes par classe énergétique. Pour évaluer l’effet du DPE sur les prix, il est essentiel de prendre en compte l’ensemble des caractéristiques du bien (surface, localisation précise, état, étage, etc.) afin d’isoler l’impact propre à la performance énergétique. C’est précisément ce que permet de faire un modèle hédoniste, en évaluant l’influence de chaque variable sur le prix de vente, toutes choses égales par ailleurs. Nous avons donc estimé l’impact des différentes caractéristiques du bien, dont la classe DPE, sur le prix de transaction par m2 des maisons et appartements par le biais d’une régression linéaire multiple (voir les informations détaillées dans l’encadré méthodologie).
La première colonne des tableaux suivants présente la décote moyenne, en pourcentage, du prix des logements selon leur classe DPE, par rapport à la classe A, toutes choses égales par ailleurs. Sans surprise, plus la classe énergétique est basse, plus la décote observée est importante. Pour les appartements, par exemple, un logement classé D affiche un prix d’achat environ 15 % inférieur à celui d’un appartement équivalent classé A. Cette décote atteint 30 % pour un bien classé G, à caractéristiques comparables.
Les maisons suivent une tendance similaire, bien que plus modérée dans les classes intermédiaires. Une maison classée D se vend en moyenne 5 % moins cher qu’une maison équivalente en classe A, tandis qu’une maison classée G subit également une décote d’environ 30 %. En revanche, les écarts entre les classes B et C et la classe A sont faibles et statistiquement non significatifs dans le cas des maisons. Cela pourrait s’expliquer par un plus faible nombre d’observations dans ces catégories dans notre échantillon, rendant l’estimation moins précise.
La hausse de valeur observée pour les logements bien classés sur le plan énergétique s’explique par plusieurs mécanismes. D’un côté, un propriétaire occupant peut espérer réaliser des économies d’énergie substantielles grâce à une meilleure isolation thermique, à un système de chauffage performant ou à l’utilisation d’énergies renouvelables. À cela s’ajoute un confort accru, en particulier en période estivale, grâce à une meilleure régulation de la température intérieure, mais aussi une plus grande adéquation du logement avec les valeurs de durabilité, qui tiennent à cœur à un nombre croissant de ménages. Ces bénéfices contribuent à renforcer l’attrait des logements bien classés, et se traduisent logiquement par une valorisation à la vente.
À l’inverse, les logements classés F ou G subissent des décotes particulièrement marquées. Celles-ci s’expliquent non seulement par des performances énergétiques médiocres, mais aussi par l’impact des récentes évolutions réglementaires. En particulier, la loi « Climat et Résilience », adoptée en 2021, interdit la mise en location des logements classés G à partir de 2025, F à partir de 2028, et E à partir de 2034. Ces restrictions touchent directement les propriétaires-bailleurs. Même un propriétaire occupant, s’il venait à changer de stratégie ou de situation (déménagement ou héritage, par exemple), se trouverait contraint de réaliser des travaux parfois lourds pour rendre son bien conforme aux exigences locatives.
Les colonnes 2 à 5 des tableaux 8 et 9 permettent d’analyser l’effet différencié de la classe énergétique selon les zones Pinel. Pour les maisons dans les zones les plus tendues (A bis / A), les décotes liées à une mauvaise performance énergétique restent faibles et statistiquement non significatives. À l’inverse, dans les zones moins tendues (B2 et C), la décote devient nettement plus marquée. Par exemple, une maison classée G ne subit qu’une décote de 5,8 % en zone A bis / A, mais celle-ci atteint 10,7 % en zone B1, et jusqu’à environ 40 % en zones B2 et C.
Pour les appartements, le tableau est un peu différent. Des décotes importantes et significatives sont observées même en zone A bis / A, ce qui indique que la performance énergétique joue un rôle non négligeable, y compris dans les marchés très tendus. Par exemple, un appartement noté D se vend 10,6% moins cher qu’un bien équivalent noté A dans ces zones, tandis qu’un appartement noté G affiche une décote de 19,6 %. Comme pour les maisons, ces effets deviennent beaucoup plus marqués dans les zones peu tendues. Pour un appartement noté G, la décote atteint près de 60 % dans les zones B2 et C.
Tout d’abord, dans les zones tendues, l’offre de logements est largement inférieure à la demande, ce qui génère une forte concurrence entre les acquéreurs. Dans un tel contexte, le pouvoir de négociation des acheteurs est limité : même un logement avec un DPE médiocre peut se vendre à un prix élevé, faute d’alternatives disponibles. À l’inverse, dans les zones moins tendues, où l’offre est plus abondante, les acheteurs prennent davantage le temps de comparer les biens et sont plus attentifs aux coûts récurrents, dont les factures d’énergie. Une mauvaise performance énergétique devient alors un levier de négociation efficace pour obtenir un rabais.
Un autre facteur tient à la composition du prix du bien. Dans les zones les plus tendues, le prix du terrain représente une part très importante du prix total, en particulier pour les maisons individuelles. Le coût d’une éventuelle rénovation énergétique pèse alors proportionnellement moins sur le prix global, ce qui atténue l’effet d’une mauvaise classe DPE sur la valorisation du bien.
Enfin, dans les zones tendues, une part plus importante des transactions concerne des investisseurs plutôt que des propriétaires occupants. Ces acquisitions s’inscrivent souvent dans une logique de placement locatif, parfois motivée par les incitations fiscales du dispositif Pinel - à noter toutefois que ces incitations ont été revues à la baisse dès 2023 (avant d'être abolies fin 2024), rendant le dispositif moins attrayant. Dans ce cas, l’attention des acquéreurs se porte avant tout sur la rentabilité locative (niveau des loyers, taux de rendement), et non sur la performance énergétique. C'est du moins le cas en dehors des classes F et G, qui subissent ou subiront prochainement l’interdiction de mise en location. Pour les classes intermédiaires (D et E), la décote sur les loyers reste faible dans les zones tendues (voir partie 2), ce qui réduit encore l’incitation des investisseurs à payer un prix plus élevé pour des logements mieux classés sur le plan énergétique.
À partir des coefficients estimés dans notre modèle hédoniste, nous avons calculé, pour chaque département de France métropolitaine, la valeur verte attendue qu’un propriétaire pourrait obtenir en rénovant une maison de surface moyenne (115 m²) actuellement classée F sur l’échelle du DPE. Deux scénarios de rénovation ont été envisagés :
Une partie de ces investissements peut être subventionnée via des dispositifs publics comme MaPrimeRénov’, le prêt à taux zéro (PTZ) ou d’autres aides locales. Leur montant dépend des revenus du ménage, mais atteindrait au minimum 4 000 euros pour la rénovation partielle et 14 000 pour la rénovation de grande ampleur (source : guide sur les aides financières 2025 de l'Agence nationale de l'habitat). Les coûts d’investissement nets seraient alors abaissés à 26 000 et 61 000 euros, respectivement.
La valeur verte représente la valorisation supplémentaire dont bénéficie une maison après rénovation énergétique (partielle ou de grande ampleur, respectivement). Les valeurs vertes les plus élevées (en euros) se situent en Corse, en Savoie et dans les Pyrénées-Atlantiques. Ces départements combinent une forte propension à payer pour la performance énergétique (notamment parce qu’ils appartiennent à des zones Pinel peu tendues, comme B2) avec un niveau de prix élevé qui amplifie mécaniquement la valeur verte. À l’inverse, les valeurs les plus faibles sont observées à Paris et dans les départements d’Île-de-France (figures 10 et 11).
Pour le scénario de rénovation partielle, la valeur verte compense le coût (net) des travaux dans la majorité des départements. Seuls six départements, tous situés en Île-de-France, ne permettent pas de rentabiliser ces travaux en cas de revente du bien. En revanche, pour le scénario de rénovation de grande ampleur, la rentabilité est plus difficile à atteindre. Dans près d'un tiers des départements (29 départements sur 96), la valeur verte générée ne couvre pas le coût net des travaux. Et la rentabilité de la rénovation complète dépend dans une large mesure des aides étatiques : si l'on ne tient pas compte des 14 000 euros de soutien, la valeur verte serait insuffisante pour couvrir les coûts (bruts) des travaux dans 57 départements.
Cela ne signifie pas que la rénovation est injustifiée, mais qu’elle devra s’inscrire dans un horizon de détention plus long, ou se combiner à d’autres motivations (réduction de charges, amélioration du confort, anticipation des obligations réglementaires).
Ces résultats font référence aux hypothèses ci-dessus concernant les coûts des travaux et les subventions. Les coûts des travaux peuvent varier selon les mesures spécifiques envisagées mais aussi l'état de la maison et les conditions de marché (par exemple, les prix de matériaux). Les aides financières sont quant à elle largement dépendantes des revenus du ménage, et peuvent rapidement évoluer sous l'effet des politiques publiques.
Considérons maintenant un appartement standard de 65 m² situé dans l’une des 50 plus grandes villes de France. À l’exception de Saint-Étienne (classée en zone B2), toutes ces villes se trouvent en zone A, A bis ou B1, c’est-à-dire dans des zones de marché plutôt tendues. Les résultats montrent que la valeur verte est particulièrement élevée dans certaines grandes agglomérations comme Paris, Rennes, Boulogne-Billancourt et Nantes : le passage d’une classe F à D permettrait d’y générer une valorisation supérieure à 30 000 euros, et plus de 60 000 euros en cas de passage à la classe B.
Dans le cas des appartements, la rénovation énergétique reste donc attractive à Paris, en dépit d’un marché fortement saturé. La différence de prix en pourcentage y est certes moins marquée que dans des marchés moins tendus, mais les prix absolus très élevés entraînent des écarts de valeur verte importants en euros. De plus, l’incidence foncière y est moins élevée que pour les maisons individuelles, ce qui augmente la sensibilité des prix à la qualité du bâti, y compris à sa performance énergétique.
À l’autre extrême, les gains associés à une rénovation énergétique sont nettement plus faibles dans des villes comme Toulon, Argenteuil, Limoges, Villeurbanne, Marseille ou Toulouse, où la prime verte ne dépasse pas 15 000 euros pour une rénovation partielle (F à D), et 30 000 euros pour une rénovation complète (F à B).
Nous avons vu que la performance énergétique, mesurée par les classes DPE, exerce un impact considérable sur les prix d’achat des logements, en particulier dans les zones où le marché est peu tendu. Mais qu’en est-il du marché locatif ? Les locataires sont-ils eux aussi sensibles à la performance énergétique, et sont-ils prêts à payer davantage pour un logement répondant aux normes environnementales les plus exigeantes ? Pour répondre à cette question, nous avons analysé un échantillon de 87 000 annonces de logements à louer, publiées en France entre avril et octobre 2024.
Il convient de noter que l’interdiction de mise en location des logements classés G, prévue à partir de 2025 par la loi Climat et Résilience, n’était pas encore en vigueur au moment de l’observation. C’est pourquoi on retrouve encore un certain nombre d’annonces pour ces logements, même s’ils restent relativement peu nombreux (figure 13). La majorité des biens proposés à la location appartiennent aux classes intermédiaires, avec environ 30 000 annonces pour des logements classés D et 20 000 pour ceux classés E.
Le loyer médian de l’ensemble des annonces analysées s’élève à 157 euros par m² et par an. Sans surprise, les loyers sont nettement plus élevés dans les zones tendues : 293 euros en zone A bis, 185 euros en zone A, contre 111 euros en zone C (figure 14).
Lorsqu’on observe la distribution des loyers selon les classes énergétiques, l’image se complique. Les classes C et D affichent des loyers médians légèrement inférieurs à ceux des classes A et B, ce qui correspond aux attentes. Mais à partir de la classe E, et plus encore pour F et G, les loyers médians augmentent à nouveau, accompagnés d’une forte dispersion. Cette configuration, déjà observée pour les prix d’achat des appartements, s’explique là encore par les autres caractéristiques des logements concernés. Les logements classés F et G sont parfois situés dans des villes ou quartiers attractifs, où les loyers sont extrêmement élevés, indépendamment de la performance énergétique. Cela peut par exemple concerner des appartements anciens, mal isolés, mais situés dans le centre de Paris.
Dans ce contexte, évaluer l’effet propre du DPE sur les loyers suppose de neutraliser l’influence des autres caractéristiques du bien, telles que la surface, la localisation, l'état ou encore le standard d'aménagement. Pour ce faire, nous avons recours à un modèle de régression multiple, qui permet d’isoler l’impact de la classe énergétique, toutes choses égales par ailleurs (voir encadré méthodologique dans la Partie 1). Afin d’obtenir des résultats suffisamment robustes et statistiquement significatifs, nous avons regroupé les classes énergétiques en trois catégories : performance élevée ou très élevée (A, B et C), performance intermédiaire (D et E) et passoires thermiques (F et G).
Si l’on considère l’ensemble des logements locatifs, toutes zones confondues, on observe une décote moyenne de loyer de 1,3 % pour les logements classés D ou E, comparés à ceux classés A, B ou C. Cette décote atteint 4,6 % pour les passoires thermiques notées F ou G (figure 16). Il existe donc bien une prime de loyer pour les logements mieux classés énergétiquement, mais elle est nettement moins marquée que celle observée sur les prix d’achat. Ce résultat est cohérent avec les conclusions d’études précédentes, notamment celle des Notaires de France en 2021.
Ces effets relativement modestes peuvent surprendre, car il s’agit ici de loyers hors charges. Or, les logements les mieux classés permettent des économies substantielles sur les frais de chauffage et d’énergie, à la charge du locataire. On pourrait donc s’attendre à ce que ces économies se traduisent par une propension à payer plus élevée des locataires, d’autant que ces logements offrent souvent un meilleur confort thermique.
Cette faible valorisation peut notamment s'expliquer par le fait que le marché locatif, même libre, est bien plus régulé que le marché de la propriété. Un nombre croissant de villes et agglomérations mettent en place des plafonnement de loyer. Et le dispositif Pinel, encore partiellement en place en 2023 et 2024, favorise aussi la location à loyer modéré. Le contexte réglementaire peut ainsi limiter la possibilité de répercuter les prix des rénovations énergétiques sur les loyers.
Comme pour les prix d’achat, les effets du DPE sur les loyers varient selon le niveau de tension du marché local. En zone A et A bis, aucune décote significative n’est observée pour les logements classés D ou E, par rapport à ceux classés A, B ou C. Dans ces secteurs très tendus, où il est particulièrement difficile de trouver un logement, les locataires semblent accorder peu d’importance à la performance énergétique, faute de pouvoir réellement choisir. Seuls les logements classés F ou G y subissent une décote, de 4,7 %.
En revanche, dans les zones moins tendues, l’effet du DPE devient plus visible. En zone B1 / B2, les logements D et E affichent une décote statistiquement significative de 1,7 %, et en zone C, cette décote atteint 3,7 %. Pour les logements classés F ou G, les décotes culminent à 6,7 % en zone C.
En tenant compte des niveaux de loyers observés dans les grandes villes françaises, il est possible d’estimer l’augmentation des revenus locatifs, en euros par an, pour un appartement type de 65 m² selon le scénario de rénovation énergétique retenu. À Paris, un investisseur pourrait espérer une hausse annuelle de revenus locatifs d’environ 1 160 euros après une rénovation partielle, permettant de passer d’une classe F à D. Une rénovation de grande ampleur, visant la classe B, n’apporterait qu’un gain légèrement plus élevé, estimé à 1 240 euros par an, soit seulement 75 euros de plus que pour la rénovation partielle.
Dans d’autres communes de la zone A bis, comme Boulogne-Billancourt, Asnières-sur-Seine, Nanterre, Colombes ou Montreuil, une rénovation de F à D permettrait également de générer un surcroît de revenus supérieur à 700 euros par an. En revanche, une rénovation plus poussée, de F à B, s’avère économiquement peu avantageuse dans ces zones. Les revenus locatifs supplémentaires qu’elle permettrait de dégager ne dépasseraient pas 60 euros par an par rapport à la rénovation plus légère.
Cette situation s’explique par les décotes de loyer très faibles, voire inexistantes, pour les logements D ou E en zone A bis. Autrement dit, une rénovation ambitieuse n’est pas valorisée par le marché locatif dans ces contextes très tendus.
Dans des villes moins tendues, comme Saint-Étienne (zone B2), les décotes liées à la performance énergétique peuvent être plus importantes, mais les loyers de marché y sont bien plus faibles. Résultat : malgré un effet proportionnel plus marqué, les gains en euros restent limités. Pour un appartement de 65 m², une rénovation de F à D permettrait d’augmenter les revenus locatifs d’environ 180 euros par an, et une rénovation de F à B d’environ 300 euros.
Notre étude confirme que la performance énergétique — mesurée par les classes DPE — joue un rôle déterminant sur la valorisation des logements en France, en particulier à l’achat, et dans une moindre mesure à la location. Les biens classés A et B bénéficient d’une « prime verte » : ils se vendent plus cher et se louent à un tarif (légèrement) supérieur à celui des logements moins performants. À l’inverse, les passoires thermiques (F et G) subissent une « décote brune ».
Cette influence varie toutefois selon la tension du marché local. Dans les zones très tendues (A bis / A), la rareté des logements entraîne un pouvoir de négociation limité pour les acquéreurs et locataires : les décotes associées aux classes DPE intermédiaires (D et E) y sont souvent plus faibles, voire inexistantes, et seule la catégorie F / G reste pénalisée.
Propriétaires occupants :
La valeur verte liée à une meilleure classe DPE est un levier important. Les rénovations énergétiques représentent souvent un investissement considérable, et les aides publiques, bien que précieuses, laissent souvent un reste à charge conséquent. Dans ce contexte, la revalorisation du bien après travaux devient un facteur clé de rentabilité, qu’il est indispensable d’intégrer dans la décision de rénovation. Elle permet également de préparer le logement à l’avenir : en particulier pour les logements classés F ou G, une amélioration du DPE offre la possibilité de les mettre rapidement en location si la situation venait à l’exiger.
Investisseurs :
Pour les investisseurs, la performance énergétique doit désormais faire partie intégrante du modèle économique d’un bien locatif. Le retour sur investissement d’une rénovation dépend étroitement de la tension de marché, des niveaux de loyers locaux et du type de rénovation envisagé. Dans les marchés très tendus, où les loyers sont déjà élevés et la demande forte, une rénovation partielle, permettant par exemple de passer de la classe F à D, s’avère souvent plus rentable qu’une rénovation complète visant la classe B, dont le coût est bien plus élevé pour un gain locatif marginal.
Pouvoirs publics :
Les écarts de valorisation selon les territoires appellent une adaptation fine des politiques d’incitation. Les primes à la rénovation, les prêts à taux zéro ou encore les contraintes réglementaires devraient être calibrés en fonction du contexte local, afin de stimuler les rénovations là où le marché ne les valorise pas spontanément.
ADNOV, Agence nationale de l'habitat (Anah), BIEN, Bien'ici, data.gouv.fr, effy.fr, engie.fr, Haut Conseil pour le Climat, hellowatt.fr, Notaires de France, prix-pose.com, travaux.com